Thalassothermie
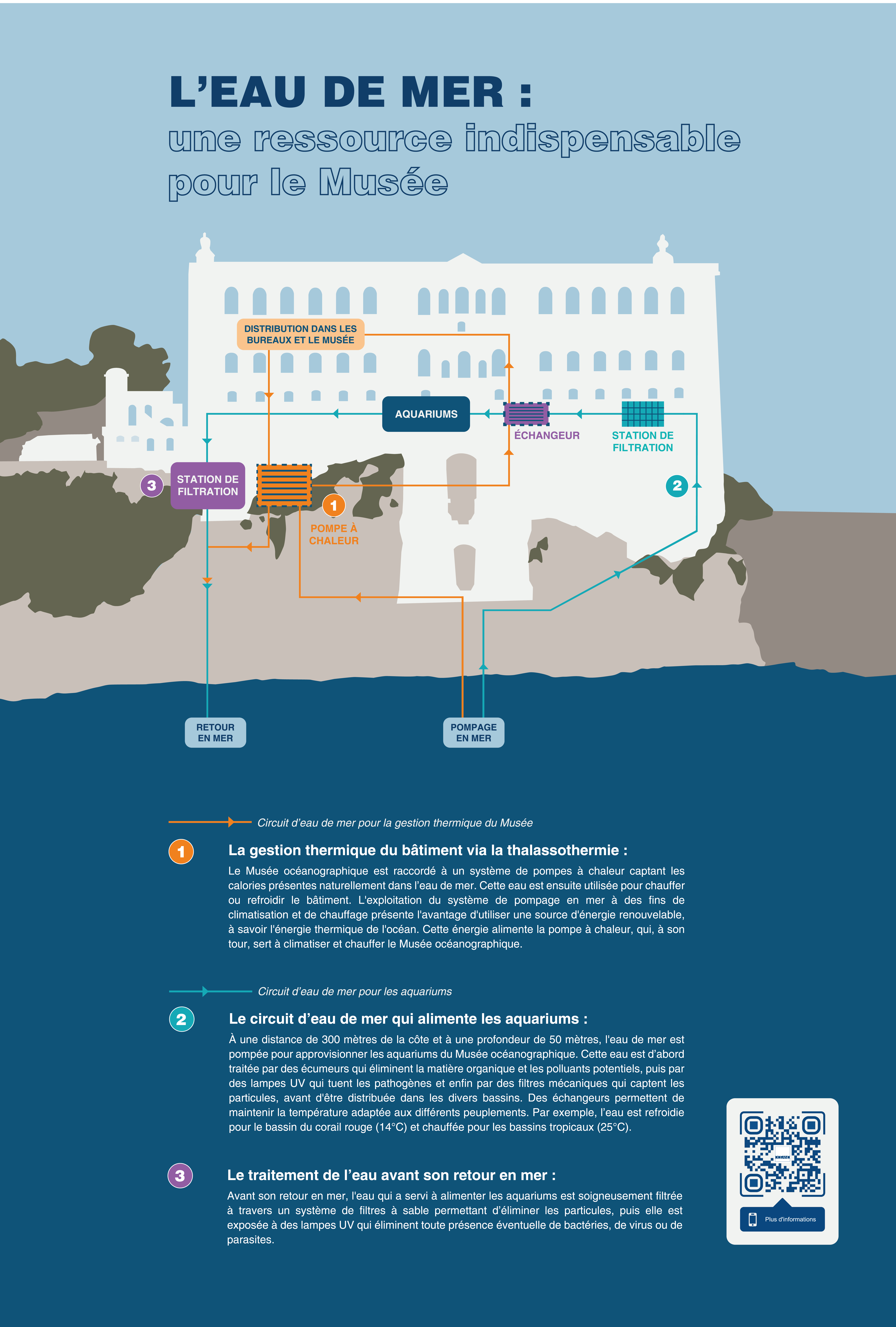
Bassins d'eau de mer
Le Musée océanographique utilise en continu de l’eau de mer pour :
- Alimenter ses aquariums
- Réguler la température du Musée de manière durable en récupérant les calories de la mer
L’intégralité de l’eau prélevée retourne à la mer après avoir traversé les aquariums ou après avoir échangé des calories avec le réseau thermique. Ainsi, le Musée ne « consomme » pas d’eau, disons qu’il en « utilise » pour son fonctionnement puis la remet en mer.
Grâce à sa situation, le Musée océanographique n’a pas besoin de « fabriquer » de l’eau de mer à partir d’eau douce, comme tous les aquariums situés à l’intérieur des terres. Et il profite aussi de la mer pour réduire sa consommation énergétique !
Hormis le bassin dédié aux piranhas, tous les aquariums du Musée océanographique sont des bassins d’eau de mer.
Comment ?
Le système actuel de pompage a été mis en place par l’Etat monégasque il y a quelques années. Il permet de prélever l’eau à 300 m au large du Musée, par 50 m de fond, ce qui garantit la qualité. L’eau est ensuite acheminée au pied du Musée par une conduite sous-marine. Ce pompage n’alimente pas que le Musée mais également les installations de l’AIEA et du CSM sur le port Hercule. Un héritage du temps où ces structures sont nées dans le bâtiment du Musée, mais aussi le signe qu’elles restent attachées à la qualité de l’eau au pied du Rocher !
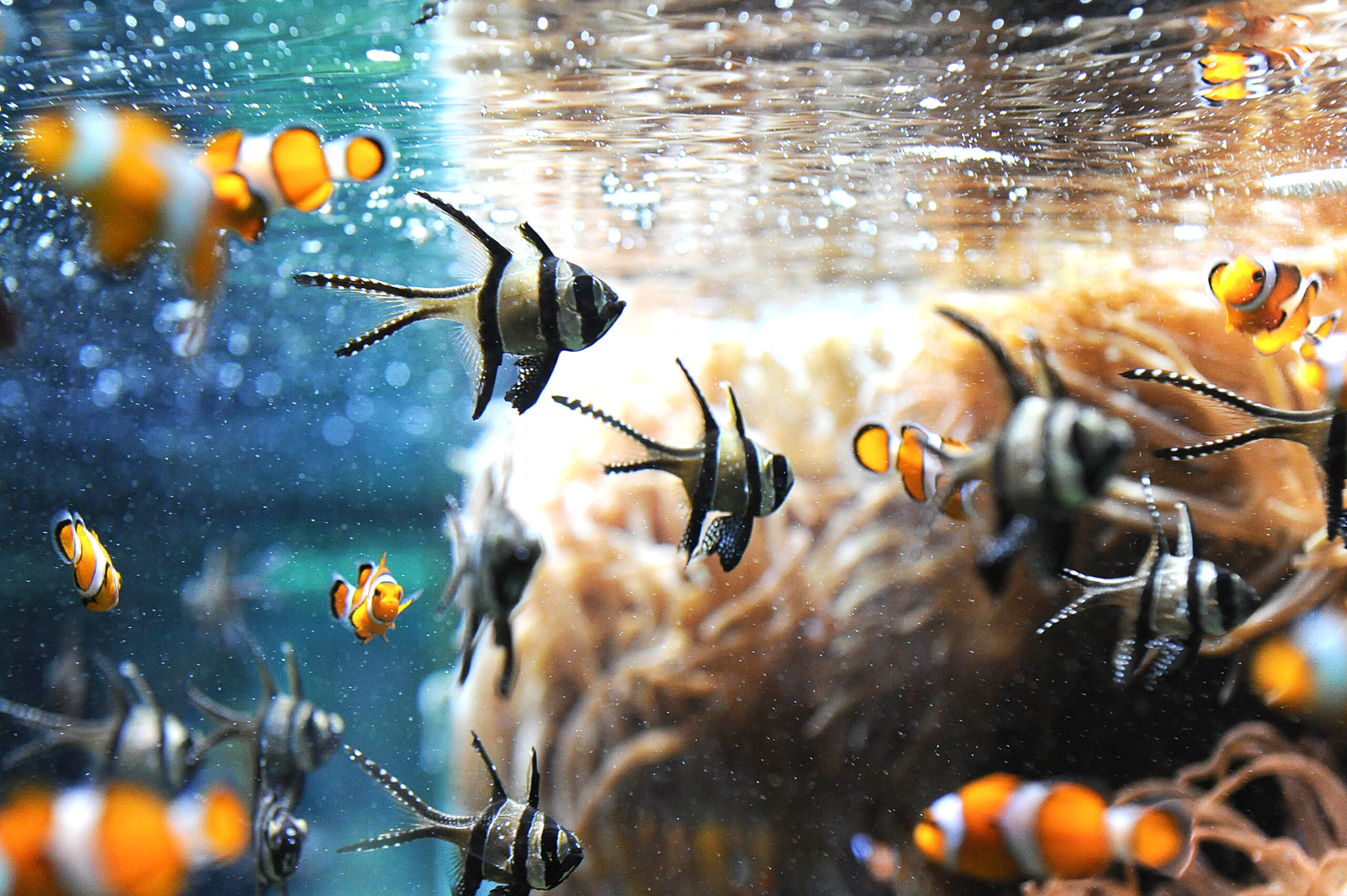
Pourquoi ?
Les aquariums du Musée représentent plus de 1 000 m3 d’eau de mer qu’il faut régulièrement renouveler afin de garantir la qualité d’eau optimale pour les animaux qui y séjournent : température adaptée à leur milieu d’origine tropical ou tempéré, taux d’oxygénation proche de 100 %, très faibles taux d’azote et de phosphore, pH autour de 8, salinité semblable à celle de leur milieu d’origine, absence de polluants.
Et en détails...
L’eau pompée pour les aquariums et le Centre Monégasque de Soins des Espèces Marines (CMSEM) arrive dans de grandes cuves qui servent de réservoirs, quelques mètres sous le parvis. Elle passe ensuite dans différents systèmes de filtration, réchauffement ou refroidissement avant d’arriver dans les bassins. Cela permet :
- D’éliminer les parasites et micro-organismes potentiellement nocifs pour les animaux (virus, bactéries etc…). Ce traitement se fait par des lampes à ultra-violets.
- D’éliminer les particules en suspension qui troublent l’eau (argile, micro-algues etc…). Ce traitement mécanique est réalisé soit à l’aide de filtres à sables (identiques à ceux des piscines), soit d’écumeurs qui éliminent ces particules dans la mousse qu’ils créent naturellement grâce aux protéines contenues dans l’eau.
- De chauffer ou refroidir l’eau selon leur destination (bassins tropicaux / bassins méditerranéens).
Une fois passée dans les bassins, l’eau retourne à la mer après avoir subi un traitement visant à éviter tout risque de contamination du milieu marin. Ce traitement mécanique (filtre à sable ou à tambour) et physique (UV) permet de capter toutes les particules, mais également de détruire toutes les cellules vivantes afin d’être certains de ne pas envoyer en mer des animaux ou végétaux de l’aquarium, ni les éventuels agents pathogènes présents dans les bassins. Un autocontrôle microbiologique amont/aval est ainsi effectué chaque mois sur la station de traitement des rejets.
L’eau qui dessert le centre de soin et le bassin de réhabilitation suit un chemin identique mais indépendant afin d’évier tout risque de contamination de l’aquarium par les animaux en soins. Après avoir traversée les bassins de soin ou de réhabilitation, elle rejoint la station de traitement des rejets, toujours de manière indépendante. Elle subit enfin le même traitement que le reste de l’eau des aquariums, à savoir filtration mécanique puis traitement par ultra-violet (UV).
L’eau est ensuite remise en mer grâce à deux canalisations visibles depuis la mer, de chaque côté du Musée.

Utiliser l’énergie de la mer
Au début des années 1930, le Dr. Jules Richard cherche déjà à alimenter l’aquarium de la manière la plus durable qui soit. Pour pomper l’eau sur plus de 50 m de hauteur, il espère utiliser l’énergie de la houle. Deux systèmes sont successivement testés, le « rotor de Savonius » et l’« ondopompe de Cattaneo ». Les principes sont bons, mais la Méditerranée n’est pas facile à dompter : soit elle est trop calme et les débits obtenus sont faibles, soit elle se déchaîne soudain et a détruit ces installations ! Voilà pourquoi, aujourd’hui, nous préférons utiliser sa chaleur.
Régulation thermique
Pour la régulation thermique (chauffage ou climatisation selon les saisons), l’eau de mer passe d’abord par des échangeurs avec un circuit eau douce primaire, qui alimente des pompes à chaleur pour en tirer les frigories/calories en vue de chauffer ou refroidir les circuits secondaires qui desservent nos installations.
C’est un moyen durable de chauffer ou refroidir en consommant un minimum d’énergie (électrique).
Pompes à chaleur à eau de mer
Les pompes à chaleur à eau de mer sont une spécialité de Monaco. Plusieurs dizaines ont été installées le long du littoral, permettant à la Principauté d’économiser l’énergie.
Une grande étude a conclu que les rejets d’eau un peu plus chaude ou froide ne sont perceptibles que très localement et n’ont pas d’effet dommageable sur la vie marine.
50 mètres de profondeur
L’eau « thermique » est également pompée aux alentours des 50m de profondeur où la température varie entre 13 et 17 °C selon les saisons, par une installation indépendante mais complémentaire à celle dédiée aux bassins.
Si le pompage destiné à nos pensionnaires marins venait à tomber en panne, nous serions en mesure de délester les installations de production thermique pour assurer le maintien du renouvellement d’eau des bassins.
retour en mer
L’eau de mer, qui ne se mélange jamais avec le circuit interne au Musée, retourne immédiatement en mer en empruntant l’une des canalisations de rejet des aquariums. L’ensemble des installations est contrôlé régulièrement par les équipes du Musée océanographique et connecté à un système d’alarme qui informe les techniciens du moindre dysfonctionnement, de jour comme de nuit.
Enfin, elles font l’objet de contrats d’entretien auprès de sociétés spécialisées et de contrôles réguliers par des organismes de contrôle agréés.






